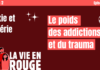Seize femmes, victimes des réseaux de pornographie French Bukkake et Jacquie et Michel témoignent dans cet ouvrage collectif puissant. Elles avaient en moyenne vingt-trois ans quand les viols ont eu lieu. pornographie sous nos regards
Pascal OP, le producteur de French Bukkake, tourne des vidéos où des hommes éjaculent en cercle sur le visage d’une femme à genoux, puis lui imposent de nombreuses pénétrations. Les femmes sont recrutées par Julien Dhaussy, sous le faux profil Facebook d’Axelle Vercoutre, qui se lie d’amitié avec des jeunes femmes fragiles, devient l’oreille de leurs souffrances, les convainc de faire de l’escorting.
Elles subissent alors un viol d’abattage par Dhaussy, qui les pousse ensuite sur les tournages de Pascal OP, dont les vidéos sont présentées comme raffinées, avec une diffusion privée au Canada. Dans des lieux inconnus, où rien ne leur est expliqué et où aucune de leur demande de limite n’est respectée, elles sont violées par des bandes d’hommes. Beaucoup d’entre elles n’osent pas porter plainte et quand elles le font, les policiers répondent : « on ne viole pas une actrice porno ».
L’affaire Jacquie et Michel, en cours d’instruction, est sensiblement proche. Michel Piron est producteur (Jacquie n’existe pas). Sous couvert de « porno-amateur », des rabatteurs manipulent pour lui des jeunes femmes en détresse économique et sociale pour les contraindre à des tournages où elles sont victimes de viols collectifs.
Chaque récit est co-écrit par une plaignante de ces deux affaires, et une autrice, chercheuse ou journaliste. L’ouvrage est introduit par l’historienne Christelle Taraud, qui dépeint l’aggravation des violences dans l’industrie pornographique depuis les années 1990, un porno « d’abatage » représentant les femmes comme des « territoires à ravager ».
À lire également : Affaires porno : l’électrochoc
Sous nos regards : des descriptions insoutenables
Seize voix distinctes, et pourtant toutes fondues dans la même horreur. La majorité a été victime de violences depuis l’enfance, frappées, violées, incestées. Des violences qu’elles n’ont pas toujours pu nommer. Et il y a celles qui s’estiment « trop gentilles », naïves, qui ont voulu aider, obéir, et qui ont été prostituées. Alice dit que c’est le point de ressemblance entre toutes les filles du procès : « Ils sentent ces choses-là, ils repèrent quand on est fragiles. »
La description des scènes de viols est insoutenable. Les corps des filles sont suppliciés, ravagés, humiliés. Elles hurlent, elles saignent, on leur demande de sourire. Ce sont souvent des jours de tournage d’affilée, des pénétrations à la chaîne, des orifices qui se déchirent. Mélanie raconte : « l’un d’eux m’a étranglée si fort que j’ai perdu connaissance. La caméra ne s’est pas arrêtée. »
A la première « mort », celle des viols, succède la diffusion des vidéos, une mort sociale. Certaines sont abandonnées par leurs amis et familles. Elles sont reconnues dans la rue, au travail, harcelées, insultées, agressées, considérées comme responsables des violences subies. En douze ans Amélie a déménagé dix-huit fois et changé vingt fois d’emploi. À chaque fois, tout recommence : « où que j’aille, quoi que je fasse, on finit par me reconnaître. À croire que la France entière regarde du porno. » Beaucoup d’entre elles ne sortent plus de chez elles, vivent la nuit.
Les vidéos se retrouvent sur de multiples plateformes de porno, visibles dans le monde entier. Si elles veulent les faire retirer, les producteurs demandent de l’argent. D’autres chantages viennent d’anonymes qui menacent d’envoyer les vidéos à leurs proches, à leurs cercles professionnels. Même quand des sites sont condamnées par la justice, les vidéos finissent toujours par réapparaitre sur d’autres sites. Ces femmes n’ont pas le droit à l’oubli. Loubna parle d’une « emprise infinie. »
Leurs récits manifestent les violences de genre, de race et de classe de cette industrie pornographique. Dans les sous-titres des vidéos et sur les tournages, elles sont traitées de salopes, de « fuck-meat » (viande-à-baiser), de « sac-à-foutre ». Elles sont appelées « beurette » ou « chinetoque ». Pascal OP reconnaît s’en prendre sciemment à des femmes de classes populaires, les désignant comme des « cassos » : « Ces filles-là sont des grosses cassos, elles n’ont pas de thune, elles sont à la rue. Mais nous on est contents, ça fait de bons vides-couilles. »
Les mots justement, ces femmes veulent les remettre à l’endroit, comme Noëlie et Pauline : « Nous n’avons jamais été actrices. Et le porno, ça n’est pas du cinéma. Ce qu’on voit sur les images est réel. Nous, on ne faisait pas semblant. Ce qu’on nous a fait, nous l’avons réellement vécu. »
Elles interpellent aussi les hommes qui regardent les vidéos, se masturbent sur leurs viols. Mélanie égrène la longue litanie des hommes qui l’ont violée et utilisée, y inclut les consommateurs de porno : « chaque jour des centaines de types me violent par procuration, jouissent dans leurs paumes moites et passent à autre chose. » Elle lance un dernier cri, en attendant le procès : « Ils m’ont bimboïfiée, pornifiée, putifiée, ils m’ont déshumanisée. Je ne suis pas une poupée. Je suis un être humain, je suis mon corps, sexué, fécond, mortel. Je suis vivante. Je demande justice. »
Anne Waeles
Sous nos regards, Ouvrage collectif, éditions du Seuil, 2025.