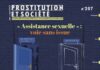Christian Delorme, prêtre, était en 1975 séminariste et bénévole du Mouvement du Nid à Lyon qui a accompagné la révolte de Saint-Nizier à toutes les étapes. Il était présent aux côtés des femmes prostituées dans l’église.
Christian Delorme, dans quel contexte le mouvement de 1975 a-t-il émergé ?
C’était sept ans seulement après la révolution culturelle de Mai 1968. Plusieurs parmi les jeunes femmes prostituées avaient vécu ces événements, soit au lycée, soit en étant étudiantes. Le climat général était à la prise de parole par des groupes minoritaires longtemps réduits au silence : les femmes (même s’il ne s’agit pas d’une minorité mais d’un groupe minoré), les personnes homosexuelles, les immigrés, les prisonniers… En ces années 1970 s’épanouissait également, en France, une Église catholique très attentive et partie-prenante des mouvements émancipateurs, progressiste et désireuse de vivre l’option préférentielle pour les pauvres et les exclus. À plusieurs reprises, des migrants sans papier avaient cherché refuge dans des églises pour y conduire des grèves de la faim. Quand une partie des femmes prostituées de Lyon a pris la décision de se lancer dans une action collective, chercher la solidarité de l’Église ne lui paraissait pas ncongru, d’autant plus qu’elle savait pouvoir compter sur le soutien des militants lyonnais du Mouvement du Nid. La France de 1975 était une France dont la majorité des habitants se reconnaissait encore dans la foi ou dans la culture chrétienne, et où les femmes prostituées s’affichaient, pour beaucoup, très croyantes.
Qu’est-ce qui a déclenché l’occupation ?
Cette première révolte collective de personnes prostituées connue dans l’histoire mondiale contemporaine, s’explique par différents éléments, même si tout mouvement social se produit généralement de façon inattendue.
Lyon avait connu en 1972 un important scandale politico-policier qui a eu un retentissement médiatique national :l’implication d’hommes politiques et de responsables policiers dans des affaires de proxénétisme. Il en est résulté une politique de répression du proxénétisme particulièrement ferme, mais aussi une répression de l’activité prostitutionnelle en général, qui a largement pénalisé les femmes prostituées. Celles-ci se sont vues accablées de procès-verbaux pour «attitude de nature à provoquer à la débauche», avec à la clé, en cas de non-paiement des amendes, des «contraintes par corps», autrement dit des peines de prison. Or, plusieurs de ces femmes étaient des mères avec des enfants en bas âge, et la perspective d’être jetées en prison leur était insoutenable.
Quel a été le rôle du Mouvement du Nid ?
La section lyonnaise du Mouvement du Nid, appuyée par le Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) de Lyon, a joué un rôle central dans cette action collective. Certes, elle ne l’a pas déclenchée, mais l’a accompagnée presqu’à toutes les étapes. Des militants et militantes catholiques progressistes, qui croyaient dans la force de l’action collective et dans la nécessité de «bousculer » les structures injustes de la société. En raison d’une présence régulière auprès des personnes prostituées exerçant leur activité dans la rue, ils et elles connaissaient bien un grand nombre d’entre elles, bénéficiaient de leur confiance.
Avec le MAN ; avec, aussi, a collaboration très active d’un journaliste du quotidien « Libération », Claude Jaget, la section lyonnaise du Nid a aidé le mouvement des femmes à s’organiser, à se structurer. Ainsi, c’est elle qui a pris les contacts nécessaires avec le curé de l’église, le père Antonin Béal, et avec l’archevêché, tandis que le MAN ouvrait son local du centre-ville pour les réunions de préparation de l’action. On parle « d’occupation » de l’église Saint-Nizier, mais il serait plus juste de parler de « prise de refuge » dans cet édifice religieux, car l’Église lyonnaise a accepté d’accueillir les personnes prostituées en révolte.
Quel était le rôle des proxénètes dans le mouvement ?
La révolte qui s’est, en quelques jours, étendue à d’autres villes, n’a pas encore fait l’objet de vrais travaux d’historiens, même si elle est restée dans un certain nombre de mémoires, au point que le 2 juin, jour de l’entrée dans l’église Saint-Nizier, est devenu la « Journée internationale des travailleurs du sexe ». Beaucoup reste à éclaircir concernant ce mouvement social emblématique. Il faudrait, notamment, explorer les archives de la police. À mon avis, il y a eu, au printemps 1975, la conjonction d’une vraie révolte de femmes prostituées n’acceptant plus les humiliations et le harcèlement policiers, une révolte presque de nature féministe ; et l’accord et les encouragements d’une partie des tenants du système proxénète. Si ce qu’on appelait alors « le milieu » n’avait pas consenti à cette action, elle n’aurait probablement pas pu exister. Les proxénètes souffraient d’un « manque à gagner » en raison de la répression policière, et ils ont sans doute considéré qu’une « petite révolte » leur serait profitable… à condition qu’elle ne dure pas trop longtemps et que les femmes en révolte n’y prennent pas trop goût !
Nous avons été témoins, au Mouvement du Nid, du fait que plusieurs femmes sont venues dans l’église Saint- Nizier sous la contrainte. De manière intrigante, l’expulsion par la police des églises « occupées », le 10 juin 1975, s’est produite juste après qu’une délégation d’avocats marseillais connus pour défendre des figures du milieu, a eu une entrevue avec le ministre de l’Intérieur de l’époque, Michel Poniatowski.
Qui étaient les femmes qui ont occupé Saint-Nizier ?
Les femmes qui sont venues se réfugier dans l’église étaient très diverses, même si la presque totalité étaient françaises, ou européennes. Plusieurs parmi elles – ce sont celles qui ont voulu et déclenché le mouvement – avaient fait des études et s’inscrivaient dans une dynamique d’ordre féministe, mais il y avait, également, des emmes venues de milieux plus pauvres et presque analphabètes. Des femmes de 18-20 ans, d’autres trentenaires ou quarantenaires, mais aussi quelques quinquagénaires. Toutes étaient réunies par leur souffrance d’être en permanence malmenées par la police, et par la peur de se retrouver en prison. Toutes déclaraient refuser tout projet de réouverture des « maisons closes ».
En revanche, des divergences existaient entre elles au sujet d’une possible « professionnalisation » de l’activité prostitutionnelle. « Ulla » et « Barbara », se sont, en effet, imposées, notamment médiatiquement. C’étaient deux personnalités assez opposées mais qui se sont révélées complémentaires dans l’action. Autant « Ulla » se présentait comme une personnalité flamboyante, aimant et cherchant la lumière des médias, mais aussi comme une femme très autoritaire ; autant « Barbara » apparaissait plus discrète, plus « intérieure », plus douce aussi. La première revendiquait haut et fort sa liberté par rapport à tout système proxénète (elle aura, plus tard, l’occasion d’admettre qu’il n’en était rien), tandis que la seconde déroulait un récit personnel plus douloureux qui rejoignait le vécu de beaucoup des femmes présentes.
Quels ont été les principaux résultats du mouvement ?
Ce mouvement n’a pas pu s’inscrire durablement dans le temps, comme certaines des protagonistes l’auraient voulu et malgré la tenue, dans les mois qui ont suivi, « d’assises » ou « d’états généraux » de la prostitution. L’expulsion des églises, le 10 juin, pouvait aussi laisser penser que ce mouvement avait été un « coup d’épée dans l’eau ». Or, ce n’est pas ce qui s’est produit. La médiatisation du mouvement, la parole directe des personnes prostituées véhiculée à travers la France par la télévision et par les radios, a bouleversé de façon manifeste, dans toute une partie de l’opinion publique, le regard porté sur ces femmes.
Les « révoltées de Saint-Nizier » ont réussi à toucher le cœur de beaucoup. Ces femmes en rébellion sont parvenues à faire changer le regard de nombre de nos concitoyens sur elles, et elles y ont gagné en dignité, ce qui n’est déjà pas rien. Les pouvoirs publics ont commencé par répondre par le mépris et par la répression à cette révolte, mais la sympathie manifestée en faveur des « femmes de Saint- Nizier » par toute une partie de l’opinion, mais aussi par la presse, a obligé le pouvoir central à adopter une autre attitude. Alors que Françoise Giroud, alors secrétaire d’État à la condition féminine, n’a pas voulu se saisir de la question, Simone Veil, en revanche, alors ministre de la Santé, a obtenu du Président de la République Giscard d’Estaing qu’il nomme un « Monsieur Prostitution » chargé d’écouter les femmes prostituées et de proposer des solutions. La tâche a été confiée à Guy Pinot, magistrat de haut rang, qui s’est acquitté de sa mission avec sérieux et cœur.
Certes, le rapport a été enterré dès sa remise, car le ministère de l’Intérieur voulait « garder la main » sur la réalité prostitutionnelle. Néanmoins, à la suite de cette révolte, et pour plusieurs années, le harcèlement policier systématique des personnes prostituées et leur verbalisation à outrance ont cessé. Aucune femme n’est allée en prison comme on pouvait le craindre avant le 2 juin 1975. Ce mouvement n’a donc pas été vain.