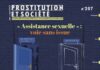« Point sur les i : la prostituée transfigurée ? » Par Daphné Proust
En cinquante ans, on pourrait croire que l’image de la prostitution a bien changé : les « travailleuses du sexe » ne sont plus réduites à des « filles de mauvaise vie », des pécheresses, d’incorrigibles créatures qui personnifient luxure et cupidité.
Au contraire, les défenseurs du réglementarisme plaident en faveur d’une « inclusion » des femmes prostituées, dont ils prétendent faire cesser la stigmatisation – unique facteur, à les entendre, de mal-être chez ces dernières. Une autre figure se dessine alors, une version prétendument progressiste de la prostitution : celle de la « travailleuse du sexe » libre, cheffe d’entreprise qui exerce son « métier » par choix.
Un choix des « clients », des horaires, des pratiques auxquelles la « travailleuse » consentirait.
Un choix qui n’est, pourtant, que rarement laissé aux personnes prostituées lesquelles, rappelons-le, ne le sont majoritairement qu’au terme d’un parcours semé de violences et d’abus. Un « travail » dans l’exercice duquel elles se trouveront soumises, quoiqu’on puisse en dire, au bon vouloir des « clients » prostitueurs : une fois réglée la transaction, on peut douter qu’ils s’embarrassent à propos du consentement et des pratiques sexuelles autorisées ou interdites.
Car c’est précisément cette notion de choix qui les dédouane de s’en soucier. Sous couvert de refuser la « victimisation » des prostituées, sous couvert de respecter leur « agentivité » et de les inclure dans le marché du travail légal, on les tient pour responsables de leur prostitution. Exactement comme on rendait les « racoleuses », « raccrocheuses », « michetonneuses » (et autres expressions qui ne manquent pas de souligner l’agentivité des prostituées), responsables de la sexualité envahissante et violente de leurs « clients ».
Un changement, un progrès, vraiment ? Libérale ou réactionnaire, la tentation de faire peser sur les femmes la responsabilité de leur prostitution semble un moyen commode de se couvrir les yeux : « Elles ont choisi. Elles aiment ça. Elles savent où elles vont. », ironise Rosen dans le Podcast La Vie en Rouge.
Ces deux discours, en réalité, ne sont sans doute que les deux faces d’une même pièce : celle que le client jette à la figure d’une femme pour épargner sa conscience, pour ne pas se préoccuper de ce qu’il lui fait.