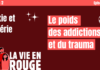Inscrire le consentement dans la loi sur le viol : une bonne idée ?
Depuis deux ans, un nouveau débat secoue le féminisme. Faut-il redéfinir le viol dans le code pénal en y introduisant la notion de non-consentement ? Une proposition de loi (PPL) a été déposée par la députée écologiste Marie-Charlotte Garin allant dans ce sens, mais l’adoption n’est pas encore définitive.
La définition du viol telle qu’elle est inscrite dans le code pénal depuis 1980 est la suivante: Article 222 : « constitue un viol “tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise” ».
Malgré cette définition améliorée au fil du temps, la prise en compte judiciaire du viol reste largement insuffisante. Des magistrat·es, des avocat·es qui défendent les victimes, constatent régulièrement que l’infraction de violence, contrainte, menace ou surprise (VCMS) reste trop difficile à caractériser dans une interprétation restrictive. Notamment, elle ne permet pas au juge d’investiguer le comportement de l’agresseur, ce qui revient à maintenir une sorte de « présomption de consentement ».
A lire également sur le sujet, notre interview de Frédérique Pollet-Rouyer, avocate
Forte de cette constatation, la juriste Catherine Le Magueresse, autrice de Les pièges du
consentement (PS n° 207), a étudié le droit international et constaté que lespays les plus avancés avaient introduit la notion de consentement dans la définition du viol. Le viol devient alors un acte de pénétration non consenti. Avec raison, des féministes et théoriciennes se sont interrogées sur le risque que cette notion ne prenne pas en compte la situation intrinsèque de domination qui préside à l’acte sexuel hétérosexuel dans une société patriarcale. Pour elles, définir le consentement favoriserait l’agresseur, qui pourrait se contenter de dire : elle était consentante.
« Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». PPL Garin
Une définition féministe du consentement ?
Éviter cet écueil est ce à quoi se sont employées de nombreuses expertes juridiques, en vue de proposer une définition qui ne laisse pas la part belle à la subjectivité de l’agresseur. Ce que propose l’article de la proposition de loi Garin et la définition du groupe de travail, réunissant une vingtaine de juristes et avocates, vise précisément à éviter cet écueil en objectivant la définition du consentement.
Dans la PPL Garin, l’agression sexuelle et le viol sont définis comme tout acte sexuel non consenti et le consentement est défini : « Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». Les « VCMS », sont par ailleurs maintenues dans le code pénal. « Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Avis du Conseil d’État et de la CEDH
Le Conseil d’État, dans une décision du 6 mars propose de définir le consentement en précisant que celui-ci « doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et constate que chacun de ces termes est en soi porteur d’une richesse de signification donnant autant de points d’appui à des poursuites mieux adaptées.
En outre, la PPL prévoit que le consentement soit aussi examiné en fonction des circonstances environ- nantes (le Sénat a préféré remplacer ce terme par « contexte »).À ce propos, la décision du 4 septembre de la CEDH qui condamne la France dans l’affaire E.A. et AVFT contre France, apporte un éclairage important. Elle affirme, dans un arrêt que l’association Osez le féminisme! juge historique, « que la justice française a manqué à ses obligations d’examiner les circonstances environnantes, de manière précise et sincère, pour apprécier le consentement de la victime ».
Mieux, elle détaille dans le paragraphe 143 quelles sont ces circonstances environnantes (voir notre interview p. 10 à 12). La PPL devait être adoptée définitivement en commis- sion mixte paritaire fin septembre 2025, mais la chute du gouvernement Bayrou a remis en cause cette échéance.
Pour en savoir plus : consentementfeministe.fr