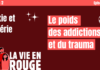Frédérique Pollet-Rouyer : « Le juge devra se demander si la victime a eu la liberté de dire non »
Un groupe de travail composé de juristes et avocates s’est réuni autour de l’idée de définir juridiquement un consentement féministe et de l’intégrer à la définition du viol. Frédérique Pollet-Rouyer, avocate auprès des victimes de violences masculines et qui a représenté l’AVFT en défense de la loi de 2016, explique la démarche.
Sandrine Goldschmidt : Pourquoi ajouter à la définition du viol le fait qu’il ne soit pas consenti ?
Frédérique Pollet-Rouyer: Le premier objectif est de faire tomber l’archaïque présomption de consentement des femmes à l’acte sexuel, qui prévaut actuellement dans le code pénal. On part du principe que les femmes seraient disponibles à n’importe quel moment, dans n’importe quelles circonstances sauf si est démontré qu’elles y ont été forcées par violence, menace, contrainte ou surprise au moment du viol. C’est un des obstacles majeurs à la prise en compte judiciaire des violences sexuelles.
Pourquoi la définition actuelle ne suffit pas selon vous ?
Parce que cette vision des choses ne correspond pas à la majorité des situations de viol. Celui-ci intervient généralement dans un contexte d’abus de la vulnérabilité de la victime qui n’est pas en capacité de réagir (sidération, alcoolisation, drogue, sommeil, handicap, dépression, très jeune âge, manque d’expérience en matière sexuelle) ou bien d’un rapport de pouvoir qui conduit la victime à devoir céder de sorte qu’il n’est pas utile à l’agresseur d’exercer violence, contrainte, menace ou surprise au moment du viol. Il profite d’une situation d’inégalité et/ou d’empêchement sans avoir besoin d’exercer un surcroit de coercition pour imposer l’acte sexuel.
Cela explique que bien souvent, chacun de ces modes opératoires soit difficile à caractériser dans l’instant du viol. À cela s’ajoute le fait que les juges en font généralement une appréciation restrictive.
C’est quoi, définir le consentement de façon féministe ?
 À l’heure actuelle, s’il n’y a pas de signes clairs et établis d’une absence de consentement, «je me suis battue, j’ai crié », ce qui est loin de représenter le mode de réaction des victimes très souvent pétrifiées par l’effraction qu’elles subissent et dans l’incapacité de s’y soustraire physiquement, la défense a toute facilité pour développer l’argu- mentaire selon lequel l’agresseur ne pouvait pas savoir qu’elle ne voulait pas.
À l’heure actuelle, s’il n’y a pas de signes clairs et établis d’une absence de consentement, «je me suis battue, j’ai crié », ce qui est loin de représenter le mode de réaction des victimes très souvent pétrifiées par l’effraction qu’elles subissent et dans l’incapacité de s’y soustraire physiquement, la défense a toute facilité pour développer l’argu- mentaire selon lequel l’agresseur ne pouvait pas savoir qu’elle ne voulait pas.
Il est donc essentiel de ne pas laisser ce mot de consentement dans le silence pour ne pas faire le jeu des agresseurs. En faisant l’effort de définir le consentement de façon féministe, comme un consentement positif et situé, on passe de la subjectivité de l’agresseur à des critères objectifs relatifs à l’expression du consentement et au contexte coercitif qui l’entoure.
La proposition de loi actuelle (PPL) définit le consentement comme devant être express (donc clairement exprimé), spécifique (à l’acte commis), révocable, ce qui est fondamental on y reviendra. Autrement dit, il ne peut se déduire de l’absence de réaction ou du silence de la victime et ne peut se donner d’avance.
Cela ouvre une nouvelle voie de droit en plus de « violence, menace, surprise ou contrainte». Si une femme est sans réaction, ou en position de soumission, le juge ne pourra plus en déduire qu’elle était consentante.
Le consentement doit également être libre et éclairé, ce qui implique de l’examiner au regard des circonstances environnantes du viol afin de mettre à jour (ou pas) les facteurs de vulnérabilité de la victime ou encore les éléments de coercition qui caractérisent la relation.
Cela veut dire que le juge devra examiner d’une part ce qui a permis à l’agresseur de s’assurer du consentement de sa victime et des mesures qu’il a prises pour cela, et d’autre part, tenir compte du contexte, entendu dans un sens large. Autrement dit, est-ce que la victime avait la possibilité de dire non, ou d’autre choix que de dire oui (un oui extorqué dès lors) compte tenu de la nature de sa relation à l’agresseur et des facteurs de contrainte pesant sur elle ?
C’est un changement de paradigme profond puisqu’on ne présume plus du consentement de la victime a priori.
A lire également : Consentement dans la loi sur le viol, une bonne idée ?
Des féministes craignent que ce soit toujours la victime qu’on interroge. Selon vous, ce ne sera pas le cas ?
À l’heure actuelle, il revient aux victimes de rendre des comptes sur leur attitude, la manière dont elles étaient vêtues, si elles avaient bu, le fait qu’elles n’aient pas suffisamment repoussé leur agresseur. Elles sont en permanence à devoir se justifier à titre personnel des raisons pour lesquelles elles n’ont pas réussi à échapper au viol, comme si elles en étaient responsables.
Dans le cadre d’une réécriture de la définition pénale du viol, incluant la définition d’un consentement positif tenant compte du contexte de la relation agresseur/ victime, on va bien au-delà du seul examen de la « violence, contrainte, menace, surprise » exercée dans l’instant du viol, en l’élargissant à l’analyse de situations de domination ou d’emprise mises en place par l’agresseur à l’encontre de la victime et des vulnérabilités de celle-ci. C’est donc bien l’agresseur qui est mis sur le grill.
Quels sont ces circonstances environnantes qui peuvent amener une femme à céder ?
Il s’agit des vulnérabilités, structurelles ou conjoncturelles de la victime, maladie, handicap, vulnérabilité psychique, parfois connues de l’agresseur, qui s’en sert pour exercer les violences, sidération, sommeil, intoxication, alcoolisation, etc. Et aussi des situations de domination ou d’inégalité telles que la différence d’âge, le manque d’expérience sexuelle, la différence de statut social, l’ascendant moral, la contrainte économique, le lien hiérarchique. Tout ce qui est lié au maintien dans l’emploi. La précarité économique est un facteur majeur de vulnérabilité.
C’est exactement ce qui ressort de l’arrêt de la CEDH (E.A et AVFT contre France, 04/09/2025) qui a condamné la France pour avoir omis de se livrer à une appréciation contextuelle des faits au regard des circonstances environnantes. Elle a entendu préciser très concrètement ce qu’il fallait entendre par « circonstances environnantes » en relevant parmi elles notamment «l’existence d’une relation déséquilibrée entre le prévenu et la victime des faits en raison notamment de son statut ou d’un lien de pouvoir ou de subordination, le jeune âge de la plaignante et sa différence d’âge avec le prévenu permettant de caractériser un ascendant moral de l’agresseur sur la victime, la connaissance qu’avait le premier des éléments de vulnérabilité de la seconde » (paragraphe 143).
Est-ce que le fait d’être un homme et le sexisme peuvent constituer des circonstances environnantes ?
C’est une des limites du droit : on ne genre pas les dispositions et les infractions pénales. En revanche, on peut, dans l’exposé des motifs, expliciter telle évolution juridique des inégalités structurelles entre les hommes et les femmes dans un système patriarcal. Évidemment, quand j’ai dans mes dossiers des éléments permettant de démontrer chez l’agresseur une conception sexiste des relations femmes-hommes et machiste de la sexualité, je le documente.
De même, je plaide avec nombre de mes consœurs pour que le contexte sexiste du viol soit pris en compte, je pense en particulier au viol commis dans un contexte de harcèlement sexuel au travail ou de violences conjugales. Affirmer qu’en patriarcat, la sexualité s’exerce sur un terrain miné par la domination masculine permet de poser des interdits et d’ériger des protections. Parmi les interdictions, il y a par exemple celle des relations sexuelles avec des mineur·es de 15 ans quand on est majeur (avec différence d’âge de plus de 5 ans) l’interdit de l’inceste, ou encore de l’achat d’acte sexuel.
Parmi les protections, il y a par exemple la définition du consentement positif à l’acte sexuel et des circonstances environnantes dans la définition pénale du viol.
Certaines préféreraient que la loi dise « le viol est un acte sexuel imposé ». Qu’en pensez-vous ?
Un acte imposé, c’est un acte dépourvu de consentement positif. Ne nous payons pas de mots, ce qui compte, c’est de pouvoir objectiver l’absence de volonté libre de la victime. Définir le consentement conduit à faciliter la défense des victimes mais aussi à faire œuvre de pédagogie et donc de prévention.
Il est important que l’on comprenne que le silence et l’absence de réaction ne valent pas consentement et que l’acte sexuel consenti relève d’une volonté commune. De même, le consentement ainsi défini est à rebours du consentement libéral qui tend à considérer qu’il pourrait être valable quelles qu’en soient les circonstances et à n’importe quelles conditions.
La seule manière d’en sortir serait d’inscrire dans le droit pénal des violences sexuelles que l’achat d’un acte sexuel est un facteur de contrainte exercé sur une victime en situation de vulnérabilité. C’est en ce sens que pousse le mouvement abolitionniste.
Certaines craignent aussi que définir le consentement puisse valider un « contrat sexuel ».
Le fait de définir le consentement positif dans la loi pénale n’a rien à voir avec le fait de valider le contrat sexuel, au contraire. Je voudrais rappeler une chose très importante. La loi de 2016 a constitué une avancée majeure dans l’analyse de la prostitution comme une chaîne de violences perpétrées à l’encontre de victimes vulnérabilisées, et fait rempart à la reconnaissance d’un contrat sexuel dès lors que le fait d’acheter est interdit. Reste que dans le cadre juridique actuel, la caractérisation du viol en situation prostitutionnelle se heurte au fait que le client est puni d’une simple contravention.
De fait, les violences sexuelles dans le cadre prostitutionnel relèvent d’un droit dérogatoire. La prostitution en soi, n’est pas considérée comme une violence relevant du viol. En gros, on pourra éventuellement obtenir des poursuites pour viol, pour les actes commis en dehors du champ de ce à quoi la personne prostituée a « consenti » (entendu ici comme libéral) par exemple s’il lui a été imposé dix partenaires ou actes au lieu des deux prévus ou des pratiques qu’elle avait exclues (courant dans le porno), ou si le client n’a pas payé.
Dans la prostitution, on sait que des femmes (en grande majorité) sont contraintes de subir des actes sexuels en raison de leur précarité ou dépendance économique auxquelles s’associent des vulnérabilités multiples, du fait notamment de violences antérieures. Considérer comme le fait notre système juridique actuel, que l’acte d’achat permettant de profiter de cette dépendance économique et de ces vulnérabilités pour pénétrer sexuellement quelqu’un·e, invalide la qualification de viol, alors même que le fait d’acheter un acte sexuel est interdit, relève de la schizophrénie !
La seule manière d’en sortir serait d’inscrire dans le droit pénal des violences sexuelles que l’achat d’un acte sexuel est un facteur de contrainte exercé sur une victime en situation de vulnérabilité. C’est en ce sens que pousse le mouvement abolitionniste. Cela impliquerait d’harmoniser l’échelle des peines encourues par les auteurs de viols et les prostitueurs.
La loi de 2016 n’est donc pas satisfaisante ?
Cette loi a été obtenue de haute lutte, ce qui explique que la sanction ait été limitée à une contravention. Mais le problème, c’est que la contravention empêche de positionner la prostitution, en tant que telle, dans le champ des violences sexuelles.
C’est donc une étape cruciale, mais seulement une étape. Nonobstant, elle pose l’interdit d’achat d’acte sexuel, ce qui est fondamental car cela fait barrage à la reconnaissance du « travail du sexe » et à un système réglementariste, ce n’est pas rien !
Et la Belgique, qui a créé un « contrat de prostitution » après avoir inscrit le consentement dans la loi ?
Les deux lois existent, mais l’une n’est pas la conséquence de l’autre. En Belgique, un lobby pousse depuis des années pour obtenir la réglementation. Rien à voir avec la loi sur le consentement. En outre, l’interdit d’achat d’acte sexuel n’est pas posé en Belgique. Or, c’est cet interdit qui protège de la reconnaissance du contrat de prostitution en France.
En quoi la nouvelle loi pourrait-elle aider à reconnaître le viol prostitutionnel ?
Définir le consentement comme révocable et donc non contractualisable est une avancée, qui peut servir pour les victimes de porno, escorting, etc. De même, permettre un meilleur examen des circonstances environnantes des faits incriminés, en particulier la contrainte économique, le contexte de violence (inhérent à la prostitution) et plus généralement des différentes formes de pouvoir s’exerçant sur la victime, est davantage susceptible de faciliter les poursuites pour viol dans un cadre prostitutionnel.
Ainsi que l’affirme la CEDH dans son arrêt du 4 septembre, « aucune forme d’engagement passé – y compris sous la forme d’un contrat écrit – n’est susceptible de caractériser un consentement actuel à une pratique sexuelle déterminée ». Autrement dit, l’existence d’un contrat n’engage pas pour l’avenir et doit également être analysée au regard des facteurs de contrainte en présence qui ont permis par exemple d’extorquer cet engagement.
Dans son avis du 6 mars 2025 sur la PPL en cours, le Conseil d’État a en outre précisé que ni l’existence d’un consentement civil (mariage, PACS, contrat sexuel) ni un accord commercial, « le “consentement” à un acte de prostitution en échange d’une somme d’argent », ne peuvent présumer l’existence d’un consentement. La révocabilité du consentement à un acte sexuel est donc bien un instrument de lutte pour toutes les victimes qu’elles soient épouses ou prostituées.
Pour les dix ans de la loi de 2016, comment aller plus loin?
Il faut une plus grande cohérence dans l’analyse des facteurs de contrainte en présence et de l’échelle des peines. Et obtenir que l’acte d’achat figure parmi les circonstances environnantes du viol comme moyen de contrainte permettant de profiter de la vulnérabilité de la victime.
Il y a en outre une incohérence entre le droit pénal et le droit civil. Selon le droit civil, le corps humain – je dirais pour ma part l’être humain – doit être sorti du marché. À l’heure actuelle, on n’en tire pas toutes les conséquences. Il faut le faire.
Pour en savoir plus : site consentement féministe